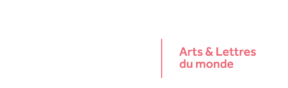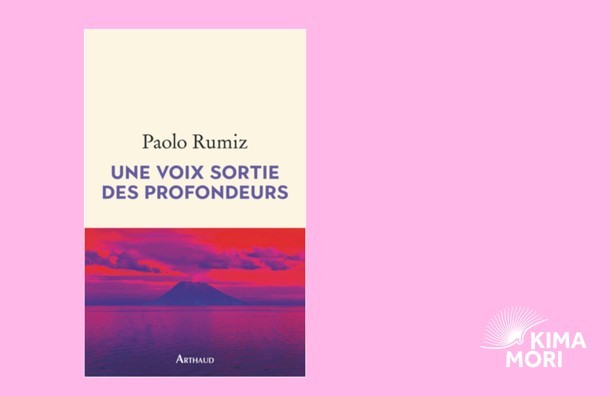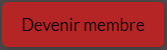« Relire l’Italie depuis le bas »
Dans La légende des montagnes qui naviguent, l’un de ses précédents livres, Paolo Rumiz se définissait comme un narrabond. Narrateur et vagabond. Ajoutons gourmand, amateur de langues qu’il cite pour le plaisir de leur musique et curieux. Voilà des adjectifsqui conviennent pour cet écrivain. Il reprend en effet des reportages pour la Repubblica et compose des récits dont chaque page nous apprend du nouveau et du singulier. Quelques titres pour se rendre dans une bibliothèque ou librairie : Aux frontières de l’Europe, périple sur une ligne entre Mourmansk et la Mer noire, Appia, dans lequel Rumiz et quelques compagnons suivent cette antique voie romaine entre Rome et Brindisi, ou Le phare, un voyage immobile : un long mois en solitaire, sur une île minuscule entre l’Italie et la Croatie : pas de réseau internet, rien d’autre que le phare habité par son gardien. Le narrabond arpente un paysage inédit : lui-même. Mais un lui-même soudain maitre de son temps. Un privilège.
Assise, Irpinia, Aquila, Amatrice : dans le « crépuscule de la mémoire », rendus oublieux de l’essentiel, nous ne savons plus ce que ces noms propres désignent. Des désastres. Paolo Rumiz a la mémoire longue ; il a des jambes, des yeux et des oreilles pour savoir et ensuite raconter. C’est donc un privilège que de l’accompagner sur les terres sismiques et volcaniques, des îles éoliennes jusqu’en Emilie - Romagne, en passant par la Sicile, la Calabre et la Campanie. Comme le titre l’indique, Une voix sortie des profondeurs, on le fait d’abord avec l’oreille : « Et maintenant on se tait et on écoute. Voici un livre qui parle d’échos, de grondements, de crépitements, de souffles. » Les espaces souterrains, grottes, cavernes, caves et autres soubassements rappellent les mythologies. On est dans les lieux d’Héphaïstos, chez Vulcain, et avec les personnages de l’Odyssée. On est dans des terres du sud colonisées par la Grèce, envahies par les Syriaques, les Lombards, les Arabes, les Albanais et que toutes les communautés ont longtemps fait vivre : synagogues, mosquées, églises byzantines et bien sûr catholiques, le sud de l’Italie est un creuset vivant. Rumiz, né à Trieste et très attaché au Karst slovène qu’il habite est un ardent défenseur du sud que les « padaniens » du Nord, l’aile la plus stupide de l’arc politique italien ne cessent d’injurier. Le mal n’a pas commencé avec eux. L’insulte « terroni » qualifiait les « terreux », les « bouseux » depuis longtemps. A Milan ou Bergame, on est encore persuadé que la Calabre et la Sicile sont des régions d’assistés, de fainéants. Mais ces « bouseux » travaillent et « toute l’histoire de la Sicile parle d’efforts et de douleur ». Le récit de Rumiz rend justice à cette moitié de l’Italie méprisée, abandonnée, qui connait les mêmes maux que bien des régions en Europe. Villages abandonnés, coupés de tout, pas seulement par un exode rural qui affecte bien des régions du monde. « En dehors des villages, c’est le néant » résume l’auteur.
Il faut d’abord voir dans cet abandon l’incurie des gouvernements successifs, avec des moments d’exceptionnelle vulgarité, lorsque l’Aquila, détruite par un séisme devient objet de spectacle lors d’un G7 ou G8 : « on avait droit à la mélasse de la compassion, aux funérailles de L’Aquila retransmises au ralenti avec des musiques qui tiraient les larmes, aux ruines mises en vedette sans aucune pudeur, en guise de toile de fond pour des leaders internationaux, plutôt que cachées comme une honte. Une chorégraphie sophistiquée qui couvrait les crimes et leurs responsables. »
Rumiz se rend dans le moindre des villages, en Calabre, puis en Basilicate, en Molise, régions à peine connues. Il nomme ces bourgades, il donne à voir des paysages qui connurent la richesse. L’eau – dont « l’admirable connaissance » est le fait des Berbères qui vivaient là, coulait partout, les forêts donnaient l’ombre et la fraîcheur, les places rassemblaient les habitants de tous âges. Ce n’est pas une vision idyllique.
Rumiz est un conservateur, au meilleur sens du terme. Il ne veut pas revenir en arrière mais préserver un patrimoine et un héritage. Et surtout les voir vivre. Or à Irpinia comme à Amatrice, la principale victime des séismes est l’esprit communautaire. Les habitants s’isolent et « l’incivilisation de consommation » exerce ses ravages. L’Italie continue d’en souffrir et de rester « dans (son) état de confusion ».
Mais tous les lieux ne sont heureusement pas affectés ou infectés. Il est en effet deux endroits, une île et une ville, qui fascinent l’auteur et vivent : Naples et la Sicile. Il les oppose pour mettre en relief ce qui les fonde et les caractérise. D’abord la présence d’un volcan. Les napolitains et autres habitants des champs Phlégréens tout proches le craignent moins que la destruction d’une terre par les nombreuses pollutions et par l’indifférence des politiques. Vivre près du Vésuve et, d’une certaine façon, le « domestiquer » par les cultures variées est tout un art, une philosophie, inaccessible aux cerveaux de Lombardie ou Vénétie. Les habitants restent sur les flancs du volcan « parce qu’il faut bien mourir de quelque chose », et « parce que tu te trouves sur le plus beau golfe du monde ». Les habitants de Catane ont un rapport semblable à l’Etna. Ils sont moins inquiets de ses éruptions que du chaos dans lequel cette ville superbe et délabrée se débat. Ils cultivent la même « désinvolture » que San Francisco, au bord de la faille de San Andreas. Et tous pourraient dire à qui les presse, ce qu’Antonio Salvati un ami du narrateur confie avec humour, « Mais toi, combien de temps tu veux durer ? ».
A travers ses très nombreuses conversations avec les Napolitains et Siciliens, Rumiz voit une opposition plus radicale entre les deux peuples, celui de Campanie, celui de Sicile. Un interlocuteur napolitain le résume en une chanson : « Pensez donc à la lumière et à l’ombre, (…). Elles ne forment pas une antithèse dramatique comme en Sicile. Une chanson comme O Sole mio, un Sicilien ne pourrait jamais la comprendre. Le Sicilien hait le soleil ». Le lucanien - partie de la Basilicate - aussi, dont un poète, Sinisgalli écrit : « Là où il y a trop de lumière, le lucanien s’éclipse, et là où il y a trop de bruit, il se planque. Il vit bien à l’ombre, il se cache. Et là où il arrive, il ne met pas tout le voisinage en ébullition ».
En Sicile, la blancheur d’un teint est une marque aristocratique. La fraicheur, celle des sous-sols ou des églises est ce que l’on recherche avant tout. Naples ne craint pas de s’exposer.
Reste ce qui unit tout le sud, et d’abord les grandes et petites villes, comme Noto, à la pointe sud-est de la Sicile : le baroque. Ce courant esthétique qui traverse l’Europe jusqu’à Prague est omniprésent et donne sens à ces terres qui tremblent, et renaissent. Mais là aussi, la renaissance n’est pas la même à Sélinonte ou Naples. La Sicile est fataliste ; Naples d’une vitalité toujours renouvelée. Un ami rappelle Conversation en Sicile, roman d’Elio Vittorini : « Le premier commandement, c’est : survivre. Fatalisme sicilien, pragmatisme napolitain ». La mélancolie distingue les deux lieux, note De Renzis, un psychanalyste : « Une macération tragique qui en Sicile est fortement présente. Naples, au contraire, digère le deuil, elle se détache de l’irréversibilité de la mort, au point d’en faire une comédie ».
A une étape de son voyage, Rumiz doit faire un choix : suivre la ligne des volcans, aller vers les îles de Toscane, ou bifurquer vers l’est et les terres secouées par les tremblements de terre. « Je me suis donc dirigé vers le nord à contrecœur. Je sentais bien que je me rapprochais d’un monde privé de porosité, dans lequel l’au-dessus et l’au au-dessous, l’au-dehors et l’au-dedans, restaient séparés, à ma grande contrariété ».
Il se rend du côté d’Assise, puis à Bologne et Ferrare. Sous la Renaissance, cette ville, sans doute l’une des plus belles d’Italie, a été grandement détruite par un tremblement de terre. Arc-boutés sur un texte du quatrième siècle, le Vatican et ses prêtres ne voyaient dans les séismes que l’œuvre divine ; les premiers ingénieurs ayant compris que la géologie existait se voyaient attaqués, voire pire. On connait les vertus de l’Inquisition.
Rumiz est un homme des Lumières. Cela ne l’empêche pas de sentir et comprendre la puissance et la beauté des croyances et de certaines superstitions. Elles viennent du monde païen qui trouvait du sens dans la Nature, dans les paysages, dans cette porosité du sol qui avait frappé Walter Benjamin à Naples.
De retour dans son Karst tant aimé, Paolo Rumiz retrouve la musique : « c’est un vibrato déjà turc, entremêlé de nostalgie et caractérisé par des fugues en direction de la musique klezmer. Un son qui arrive du Danube, de la Volga, des terres de la Bible. De l’Orient ».
Le voyage se termine ; un autre est à venir. Espérons-le proche.
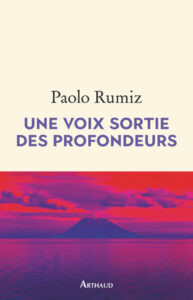 UNE VOIX SORTIE DES PROFONDEURS
UNE VOIX SORTIE DES PROFONDEURS
(Una voce dal profondo)
Paolo Rumiz
Traduit de l'italien par Béatrice Vierne
éd. Arthaud, 2025 (v.o. 2023)
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.