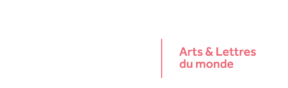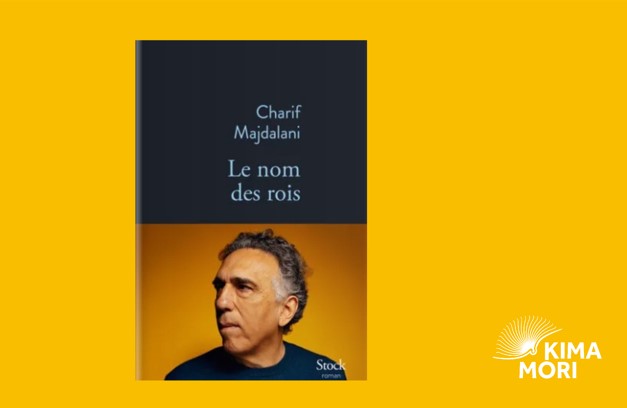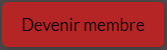Sous les noms
Le nom des rois est l’histoire d’un enfant rêveur, le narrateur, n’aimant rien d’autre que les livres, sa solitude et les noms propres qui alimentent son quotidien. Longtemps sa famille et lui (et une servante nommée Nawal dont les propos ou commentaires ajoutent souvent une touche ironique au récit) vivent dans la paix et un certain confort : « J’habitais en ce temps-là un pays dont on se demande avec étonnement aujourd’hui s’il a vraiment existé ». C’était celui des Trente Glorieuses, puisque le Liban, né en 1945, a sombré dans la guerre en 1975.
Roman d’initiation, Le nom des rois relate des apprentissages. Ils commencent avec les noms propres qu’il recopie dans un cahier, extrayant leur précieuse matière sonore de sa gangue pour la restituer à la lumière du jour, « une lumière qui devait en faire chatoyer les formes ». Les noms sont une histoire qu’on lit ou reconstitue quand on ne l’invente pas. A les connaitre, à les prononcer, on a vite tendance à voir un sarcophage à la place d’un abreuvoir, à croire que les figures mythologiques errent dans la montagne.
Après les noms viennent les êtres, camarades de classe que l’on perdra de vue, et retrouvera après la déflagration, s’ils n’ont pas quitté le pays. Et parmi ces êtres, la rencontre sublime des filles, Anaïs, Simone, Esther puis Clara. Le narrateur a pour cette dernière le coup de foudre. Nous ne dirons pas quel rapprochement il fait. L’ironie, encore.
A un moment du roman, le narrateur évoque la Buick du chef bédouin. Un tel véhicule correspond à l’esprit de ce roman, on sent que le chauffeur se délecte.
 LE NOM DES ROIS
LE NOM DES ROIS
Charif Majdalani
éd. Stock, 2025
Sélection Prix Goncourt 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.