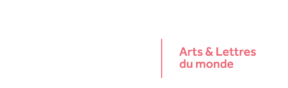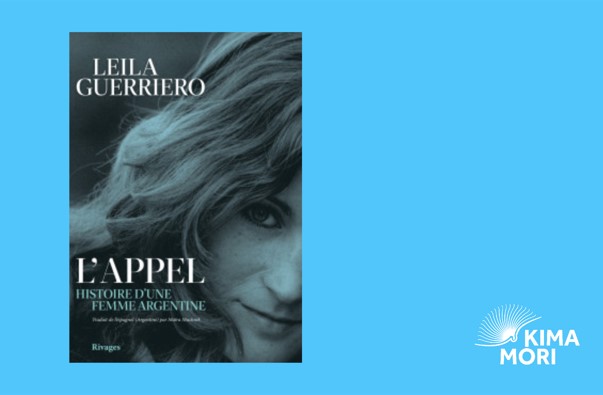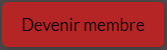Être enfin écoutée
L’essentiel du récit est constitué de dialogues avec Alberto, premier mari de Silvia et père de Vera, avec bien d’autres compagnons de vie ou amis qu’elle a fréquentés ici ou là, avec le moins loquace Hugo Dvoskin, l’homme de sa vie, connu au Colegio quand elle éblouissait les garçons par sa beauté et son allant, retrouvé à Buenos Aires, après bien des années passées à Madrid. Les témoignages sont très nombreux, pris par bouts, sans cesse complétés. Des récits évidemment contradictoires pour dessiner la figure de cette femme argentine. Une vie est un patchwork dans lequel toutes les pièces comptent, et la journaliste les assemble avec une forme d’enthousiasme lié à la personnalité de Silvia. Avoir survécu à la torture, au viol, à l’enfermement, à la séparation d’avec un enfant tout juste mis au monde montre que la jeune femme avait une force de caractère assez unique.
La vie de cette femme argentine est emblématique en ce que tout, dans son enfance et sa jeunesse devait lui assurer une existence paisible. Elle avait fait ses études dans l’établissement public le plus sélectif du pays et y avait connu la plupart de ses amis. Silvia n’était alors pas engagée sur le plan politique. Elle appartenait à une famille de la bonne bourgeoisie comptant de très nombreux militaires. Son père travaillait comme pilote de ligne après avoir été officier. Précisons cependant que Betty, sa mère, et Jorge, son père, étaient deux personnalités explosives. Très belle, séductrice, tempétueuse, Betty attirait les regards. Le père était lui aussi un séducteur invétéré en des temps que l’on qualifiera de permissifs. Et ce, dans un pays très conservateur, dans lequel le christianisme avait quelque chose de l’Inquisition. Pendant son enfermement, Silvia le constatera plus d’une fois. La répression se fait au nom de la chrétienté. Les militants révolutionnaires ont peu de chances de survivre, surtout s’ils sont d’extraction populaire, ou juifs. Sur ce plan, les tortionnaires et violeurs n’ont pas trop de scrupules moraux.
Et puis Silvia connait le soupçon qui pèse sur tous les survivants dans des circonstances aussi tragiques. S’ils sont revenus, c’est qu’ils ont laissé d’autres mourir à leur place, qu’ils ont collaboré avec l’ennemi ou le gardien. Les déportés rentrés d’Auschwitz ont subi cette offense, ou se la sont infligée. Beaucoup se sont suicidés, se sentant coupables de vivre. L’histoire de Silvia est celle d’une femme qui ne renonce à rien, ni à l’amour, ni à la vie, ni à ce qu’on fasse justice. Et qui la dénigre, la critique voire l’accuse se trouve confronté à cette femme qui se bat, après avoir longtemps tu ce qu’elle avait subi à l’ESMA.
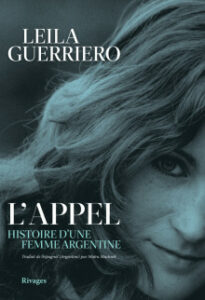 L'APPEL, Histoire d'une femme argentine
L'APPEL, Histoire d'une femme argentine
(Llamada, Anagrama)
Leila Guerriero
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Maira Muchnik
éd. Rivages 2025 (2023)
Sélection Prix du meilleur livre étranger 2025 catégorie non-fiction
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.