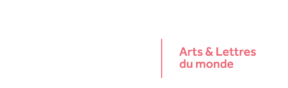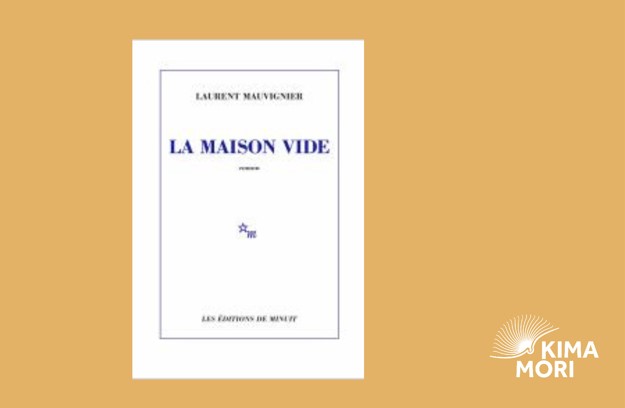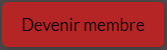On connait les idées de Kundera sur le roman, en tant qu’exploration de territoires méconnus ou inconnus, comme œuvre de connaissance. Peu de romans français, aujourd’hui, remplissent cette « mission » sans tomber dans le témoignage ou le documentaire. Certes, des écrivains abordent des « sujets », ils les « traitent » mais trop souvent le lecteur a le sentiment de lire de la « non-fiction ». Depuis Loin d’eux, son premier roman, Mauvignier a confiance dans ce genre incarné par Flaubert, Claude Simon, Duras ou Echenoz. Je ne cite pas ces noms par hasard. Avec Antonio Lobo Antunes et Thomas Bernhard, ils sont parmi les sources de Mauvignier. Il les cite dans Quelque chose d’absent qui me tourmente et pour diverses raisons, on sent qu’ils sont là, dans La maison vide.
A commencer par le piano, personnage à part entière. Il est le meilleur ami de Marie-Ernestine, arrière-grand-mère du narrateur. Elle vit avec lui, reste seule avec lui et toute son existence tourne autour de lui davantage qu’autour des êtres près desquels elle doit vivre : ses parents d’abord. Son père Firmin, riche fermier possédant terres, ferme, bois et scierie. Sa mère, longtemps appelée « la minuscule préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser » avant qu’elle soit nommée : Jeanne-Marie. Le piano est plus important que Jules, l’époux qu’on lui a donné, plus que Marguerite, la fille qu’elle aura avec ce mari et bien des épisodes dramatiques du roman se déroulent dans la pièce où il se trouve.
Les autres objets, et notamment la Légion d’Honneur ou les photos sur lesquelles un visage a été découpé témoignent de deux vies brisées : celle de Jules, héros de la guerre de 14, et Marguerite, tondue à la Libération. Ils reviennent dans l’épilogue, eux aussi personnages à part entière.
Le roman, bâti en cinq parties qui sont peut-être autant de pièces de la maison raconte des vies brisées, des espoirs déçus, la mort qui souvent rôde et frappe. Le suicide est présent, qu’on le tente ou qu’on l’accomplisse. Le père du narrateur s’est tué au début des années quatre-vingt. Qui a lu Des hommes, roman sur les récits et échos de la guerre d’Algérie sait que ce père a été appelé. Il ne s’en est jamais remis. La maison vide plonge également dans une histoire et dans l’Histoire. Jules, l’arrière-grand père a vécu les tranchées. Mauvignier décrit cette épreuve. Or comme l’écrit Echenoz dans 14, on a tellement écrit sur cette guerre que « cet opéra sordide et puant » ne se raconte plus. Ou alors autrement, et chez Mauvignier par le maelström des sensations, par une débauche de détails visuels, olfactifs, tactiles, par des phrases heurtées sans verbes pour mieux traduire ce que perçoivent les hommes. Cela vaudra pour la débâcle de 40, avec les flots de réfugiés qui passent à La Bassée et dans ses environs, non loin des bords de Loire.
Le lieu du roman est toujours La Bassée. Dans Histoire de la nuit c’était dans le centre de la France ; on est ici près du fleuve et la petite ville sera l’une des frontières de la France occupée, sur la ligne de démarcation. Cette ville fictive est le territoire du romancier. Qui a lu Giono, Faulkner et quelques autres sait ce que sont les territoires romanesques.
Le romancier ne montre pas l’Histoire comme on le fait dans les documentaires. Elle est un flux continu, avec ses méandres, ses moments saillants qui ne sont pas forcément les plus visibles, et ses lenteurs. Le narrateur use de l’accéléré pour l’année 40. Entre les derniers soubresauts de la IIIème République et l’arrivée des soldats allemands en France, ce sont des dates, des faits qui s’accumulent, un peu comme on arrachait les pages des éphémérides dans des films des années quarante
Dans les premières parties du roman, avant 14, la lenteur l’emporte. Souvent l’ennui et l’habitude. Marie-Ernestine est une élève brillante dans son école catholique. Elle suscite des envies et jalousies. Elle est aussi la fille du riche Firmin Proust (tel est le nom de la famille et comme le note le narrateur ironique, à l’épuisement du nom rien ne sera vraiment perdu). Marie-Ernestine traite ces jalousies par le mépris. Elle veut entrer au Conservatoire et cela seul la guide. A ses côtés, Florentin Cabanel, son professeur, voire son Pygmalion.
Le rythme change à l’après-guerre. La maison se vide quand La Bassée entre dans la modernité : des boutiques ouvrent. Marguerite devient apprentie. Elle rencontre chez Madame et Monsieur Claude, les propriétaires d’un magasin de vêtements et accessoires, une certaine Paulette, son âme damnée. Son patron s’accorde avec elle des privautés ; elle se sert de lui et le manipule. Elle initiera Marguerite au monde réel, et au sexe. Tout ce qui était interdit, caché, dans la maison tenue d’une main ferme par Jeanne-Marie devient débridé. Le narrateur use du dialogue ou du monologue et fait entendre Paulette. Elle n’a aucune limite, aucun scrupule, peu de tabou. Quand elle « monte » à Paris, ses « ambitions » traduisent ce qui se vit à l’échelle du pays. Disons pour rester sobre, « apocalypse joyeuse ». Mauvignier, qui a étudié et pratiqué les arts plastiques, écrit comme Georg Grosz et Otto Dix peignent. C’est violent, précis et juste.
Dans cette société en fusion, il y aura les perdants et les gagnants. On se doute que les femmes sont forcément dans le lot des premiers. Quand Firmin marie sa fille, il donne tous ses biens à Jules, son gendre. Lui-même soumet son épouse à tous ses caprices ; on sait lesquels. La guerre seule libère Jeanne-Marie. Elle était dans l’ombre, elle mène sa ferme avec autorité, gouverne sans craindre quiconque.
Marie-Ernestine, longtemps recluse, occupée à son piano, reste une victime : remariée à Lucien, un notaire, elle sera flouée. Marguerite enfin, héroïne à la Duras (on songe à Hiroshima mon amour, entre autres) sera selon les beaux vers d’Eluard « La victime raisonnable/ A la robe déchirée/ Au regard d'enfant perdue/ Découronnée défigurée/ Celle qui ressemble aux morts/ Qui sont morts pour être aimés ».
Les gagnants se reconnaissent. Ils plastronnent quand Marguerite est humiliée, comme le couple Claude ou ils agissent en sous-main, tel Lucien. L’argent n’est pas seulement le titre d’un roman de Zola. Florentin Cabanel avait fait lire Les Rougon-Macquart à son élève préférée.
Revenons-en là, au roman, à ce genre si ductile, si vivant, si mobile que le romancier aime, pratique avec de plus en plus de maitrise, d’ambition. Sa phrase que l’on a connue heurtée, débordante, comme la respiration d’un asthmatique (mais, on l'a dit, des ancêtres de Mauvignier s’appelaient Proust) est ici plus souple, fluide, majestueuse. Elle défile comme la Loire. L’usage fréquent du discours indirect libre évite les dialogues théâtraux, les face à face et montre ce que l’échange doit au récit entendu. L’enfant qu’il était a en effet entendu ces histoires, du moins certaines. Ecrire, c’est inventer à partir de quelques images. Ici, une femme tondue et un héros mort au champ d’honneur et cette invention est ce qui rend la vérité plus qu’une copie « réaliste » des faits. On le sent très fortement dans les pages consacrées à la période de l’Occupation. Tout sauf simpliste et manichéenne.
Imaginer est aussi et surtout ce qui rend la poésie d’un roman dans lequel quelques objets, la branche d’un cerisier, un bouquet de marguerite ou un petit foulard en soie jaune ont autant d’importance que des personnages.
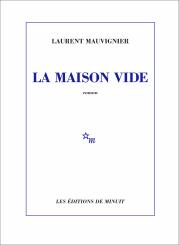 LA MAISON VIDE
LA MAISON VIDE
Laurent Mauvignier
éd. de minuit, 2025
Sélection Prix Goncourt 2025
Sélection Prix Jean Giono 2025
Sélection Prix Femina 2025
Sélection Prix Médicis 2025
Finaliste Prix Landerneau 2025
Lauréat Prix des libraires de Nancy 2025
Lauréat Prix Le Monde 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.