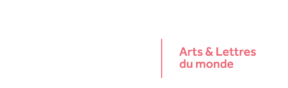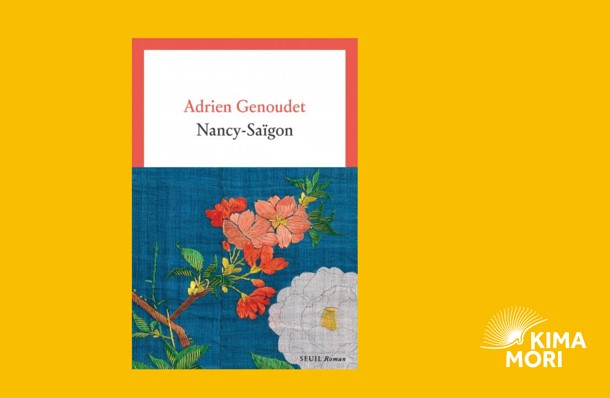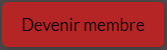Vies d'une tunique
Épouse de Paul Sanzach, Simone avait eu un enfant avec lui avant le mariage en 1945, alors que le couple vivait une idylle près du lac de Constance. Edithe, a été « la fille de trop ». Elle est celle avec qui le narrateur correspond, de qui il tient les informations concernant le couple parental. Lui, devenu militaire de carrière, est parti en Indochine ; elle est restée à Nancy, l’a vainement attendu.
La correspondance que lit le narrateur lui en apprend beaucoup sur le couple mais aussi sur un certain Tilleul, soldat expédié par son père du Jura dans la jungle vietnamienne, devenu ordonnance de Sanzach avec qui il entretient des rapports troubles. Disons, sans aller plus loin dans la présentation de l’intrigue que le trouble fait la matière même de ce roman très écrit.
Le narrateur lui-même ne sort pas indemne du malaise qu’il trouve dans les lettres. Il habite un studio, avenue d’Italie, là même où l’essentiel de la communauté asiatique demeure, et à son étage, seul un vieil homme d’origine vietnamienne habite. Avant la crise COVID, ils échangeaient et monsieur Trân nommait les lieux du pays natal. Le confinement les éloigne, et d’une certaine manière, ce que vit le narrateur fait écho à ce qu’ont connu les soldats français enfermés dans « Le hérisson », un camp au milieu de la jungle. Un espace qui imprègne les corps et se fait entendre jusque dans la phrase : « Des sons sciés d’insectes de toutes parts réveillés par la chaleur. C’était assourdissant sous les casques, et avec l’humidité collée aux torses, la fatigue au bout des jambes, l’objectif morne, les hommes étaient devenus nerveux et découragés par les heures à venir ». La guerre est faite d’attentes inquiètes et de soudains assauts. Elle n’a pas beaucoup de sens : « Le poste devait tenir, un point c’est tout. La mission se résumait à cela, et à vrai dire, une grande partie de la guerre se résumait à cela : tenir pour rien, en improvisant, au beau milieu de nulle part ».
Un nulle part qu’entoure une armée invisible, insaisissable : le Vietminh a l’art d’apparaitre et de disparaitre. Brunet, un capitaine qui a déjà mené une campagne dans le pays terrorise le jeune Sanzach par ses récits, lui expliquant comment d’une tige de bambou les maquisards conçoivent d’atroces pièges. Le capitaine et le lieutenant sont encore sur le Pasteur, le paquebot qui convoie les troupes et ce récit de Brunet est déjà une façon d’engager le rapport de force. Il a été de cette première expédition dans laquelle « on partait bien souvent pour le seul sentiment tangible du mouvement même, une façon de déjouer des sensations de génération bancale, sacrifiée d’après-guerre ». Sanzach a connu les maquis du Morvan, puis l’engagement dans l’armée Rhin et Danube. Mais on comprend mal l’engagement en Indochine si on oublie ce qui a précédé.
De la vie de Paul Sanzach, Simone ne sait pas grand-chose. Elle l’aime, aveuglément. Elle ne le voit pas, ni au sens figuré, perdu qu’il est dans le maelström vietnamien et ses dérèglements de toutes sortes, ni au sens propre. Sa cécité commence avec une forte myopie. Dans ses ultimes années de vie elle est aveugle, dépendant d’Edithe. A peine si elle sent que sa « famille » fait de sa fille « celle-qui-est-là » en « bord de table ». Elle ne voit pas davantage que Paul s’éloigne d’elle, que ses lettres deviennent de plus en plus creuses, dénuées du moindre élan sentimental. Elle lui envoie un colis lorsque leur fille Edithe nait ; il lui envoie la fameuse tunique qu’elle portera jusqu’à son dernier jour. Nous tairons la façon dont il se l’est procurée. Un leitmotiv revient dans les propos de Simone : « ils m’ont pris mon tilleul ». Il était planté dans le jardin face à elle. On l’a réduit en rondins. Et comme en écho, comme un signe, il y a Tilleul, qui suit Paul comme son ombre.
Dans ce roman à la fois limpide et dense, les personnages émergent peu à peu. Tilleul est de ceux-là. Sur le port de Marseille, il fait la connaissance du couple que forment Paul et Simone. Son comportement équivoque inspire la méfiance de celui qui sera son chef. La traversée sur le Pasteur est un cauchemar à tous égards. Dans l’étuve qu’est le fond de cale puant où il est reclus, il est devenu le bouc-émissaire. Il se fait massacrer par un autre engagé, est près de mourir avant d’arriver à l’hôpital militaire de Saïgon.
Avant d’arriver au Hérisson, la troupe séjourne dans la capitale et plus spécialement à Cholon, le quartier des plaisirs. Quand tous ses compagnons s’égarent dans les orgies, Tilleul reste en retrait. La forêt le transforme ; il y retrouve, autrement bien sûr, quelque chose de la forêt jurassienne de son enfance : « Tilleul avait fini par apprécier la texture même de la guerre en Indochine, où tout paraissait à la fois inutile, perdu d’avance et dans le même temps viscéral comme peut l’être l’étendue de la jungle ». Il s’immerge dans ce paysage comme si la boue originelle le métamorphosait. Au terme de l’épreuve ou presque, il deviendra une légende : « Tilleul colmatait, bouchait les trous des mémoires, il prenait le contour des absents et des soldats inconnus, on lui trouvait même des ressemblances et des doubles dans des accrochages ». A l’instar de l’ennemi vietminh, il apparait, disparait et ce tilleul-là, nul ne semble pouvoir l’abattre.
Nancy-Saïgon est de ces romans qui envoûtent sans jamais cesser d’éclairer sur ce moment de notre Histoire que peu de textes littéraires retracent. On ne sort pas aisément de cette lecture. Mais les vrais livres suscitent un légitime malaise.
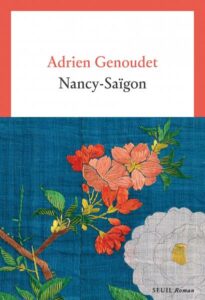 NANCY-SAÏGON
NANCY-SAÏGON
Adrien Genoudet
éd. du Seuil, 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.