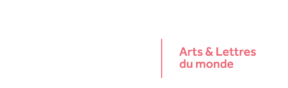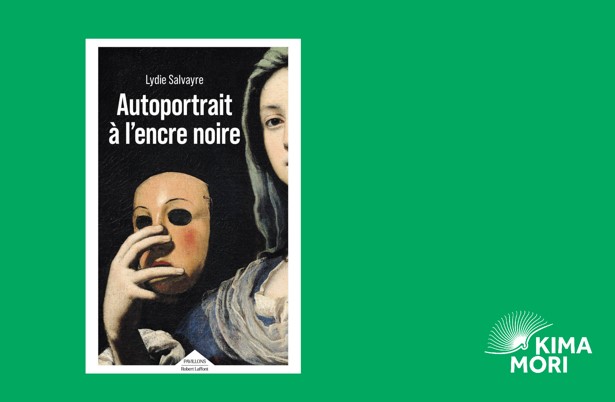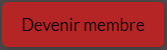D’une sincérité excessive
Lydie Salvayre s’est lancée dans « le sot projet de se peindre ». Ainsi se résume le jugement de Pascal sur l’œuvre de Montaigne. Notre autrice cite ce dernier en exergue de son Autoportrait à l’encre noire et comme lui, elle peint le mouvement plutôt que l’être. Son autoportrait n’en fait pas une statue.
Lydie Salvayre est romancière. Elle a reçu le Prix Goncourt pour Pas pleurer, portrait de sa mère en jeune fille, et dans les pages qu’elle consacre à ses parents, elle revient sur le moment exaltant que Montse a connu au tout début de la guerre d’Espagne, à Barcelone. Mais aussi sur la suite : fuite vers la France, camps d’internement, misère et vie commune avec le père de l’écrivaine, un homme dont la colère n’est jamais retombée, violent avec son épouse comme avec ses filles. Mais c’est là le résumer faussement et dans un des plus beaux chapitres du livre, « Un rebondissement », on verra que tout est plus complexe, et bouleversant.
Peindre le mouvement plutôt que de se figer sur une toile est bien ce qui définit ce livre. La narratrice s’interroge sur l’intérêt d’un tel projet : « Je, je, je, moi, moi, moi, de tous les pronoms, les plus abjects, avait écrit mon admiré Carlo Emilio Gadda ». Elle ne supporte pas « les individus entichés d’eux-mêmes » et dès le premier paragraphe du récit, elle ne se fait pas de cadeau : « J’ai vieilli. J’ai mochi. » La suite est à l’avenant et il ne s’agit pas d’une pose ou de s’apitoyer sur soi-même. Elle est souvent dans l’auto-dérision et la vie lui a donné le goût de la satire, qui s’exerce plutôt, il est vrai, contre les autres : en l’occurrence les puissants, les nantis et les imbéciles. Il y a de quoi faire.
Elle n’aime pas les mondanités et n’a toujours pas digéré un propos entendu dans un salon fréquenté par la crème du littéraire. Un familier des lieux et des petits fours lui trouvait « l’air bien modeste ». L’adjectif n'avait pas le sens que nous préférons. Le personnage en question ne savait pas qui elle était, ni d’où elle venait. Elle était cette fille de réfugiés espagnols qui avait connu la pauvreté et la honte. Mais elle ne jouait pas le rôle si « actuel » du « transfuge de classe ». Trop envie de passer outre, d’abord en conquérant sa langue. Elle devient écrivaine à quarante ans passés et se demande pourquoi, dans l’un de ces nombreux passages du livre qui sont davantage des questions insolubles que des affirmations : « est-ce cet échec à maîtriser une langue que je désire, d’autant plus qu’elle m’échappe ? Est-ce ce point de faillite qui exige de moi le recours à l’écriture ? Pour le dire autrement : si je m’étais senti propriétaire de la langue et dans une adhérence parfaite et confortable, et uni à une histoire, serais-je advenu à l’écriture ? » Elle écrit parce qu’elle ne sait pas parler, elle trouvera sa langue et s’affranchira du père destructeur qui suivait si fanatiquement la ligne du Parti stalinien qu’il n’avait plus trop de mots. Lydie Salvayre, jeune fille énamourée vivra une expérience voisine avec un certain Pablo, militant trotskyste qui parle « comme un curé ». Les langues mortes ne sont pas trop faites pour elle.
On ne s’étonnera pas que la famille et l’institution du mariage ne soient pas trop de son goût. Dans une énumération de « non merci ! » Lydie Salvayre montre tout ce qui lui déplait dans « cet enlisement lent, ces pantoufles mentales, cette mort des désirs ». Dans un autre chapitre intitulé « La touche bienfaisante », titre ironique au possible comme l’est l’antiphrase, elle relate quelques moments de sa vie de pédopsychiatre et c’est tristement éloquent. Mais la charge contre le mariage n’empêche pas la romancière de parler de Bernard, son compagnon, dont elle a dressé un portrait dans B.W. en 2009. Si elle aime la solitude, l’autrice ne peut vivre sans les autres. Et par exemple pas sans Albane, son Sancho Pança.
L’autoportrait ne peut avoir l’exactitude de l’autobiographie dans laquelle, souvent selon un ordre chronologique, on se raconte par le menu, en jurant de tout dire. Cette promesse n’est pas toujours tenue et la mémoire ne manque pas de failles très utiles. Lydie Salvayre n’a pas cette prétention ou cette ambition. Albane, sa voisine, est l’autre qu’elle aurait pu être, si l’envie d’apprendre, d’aller contre, ne l’avaient pas poussée à étudier, d’abord les lettres puis la médecine. Et de trouver sa langue. « Contre » : c’est le titre d’un texte qu’elle a écrit et lu. C’est ainsi qu’elle avance. Les échanges avec Albane sont très drôles, pleins d’une verve qui est la caractéristique du style Salvayre. Entre la jeune employée qui recherche l’âme sœur et l’autrice, le cœur de la conversation est la littérature. Albane aime la romance, et même la love romance. L’histoire de Cynthia, maquilleuse, et d’Adelin, journaliste qu’elle aime est son modèle. Albane suit les recommandations de Sandra, tiktokeuse « aux lèvres tuméfiées ainsi que la poitrine » et elle aime la love story « trop prenante, trop poignante, trop attachante, trop grisante, trop captivante » etc. On reconnait là la façon d’emballer la marchandise dopée à l’hyperbole.
L’hyperbole, l’excès, la romancière n’a toutefois rien contre. Depuis sa découverte de Quevedo, « le plus baroque des écrivains baroques », elle aime ce qui est excessif : « excessif dans l’irrévérence, excessif dans la satire, excessif dans le grotesque, excessif dans le mauvais goût et excessif dans la virtuosité de la langue ». Mais réduire le style Salvayre à cet excès serait une erreur. Du classicisme tel qu’il s’incarne dans la littérature française, elle aime « la perfection, la pureté, l’économie, l’élégance racée ». Quand on lit La puissance des mouches roman très marqué par la présence de Pascal, l’un de ses maitres ou Rêver debout, consacré à la figure du Quichotte, on voit comment elle marie la « carpe classique » au « lapin baroque ». Et l’on savoure le plat. La romance selon Albane est remplie de péripéties, longuement développée. Lydie Salvayre écrit sans fioriture, et elle cite Pline le jeune qui, « ayant une lettre à écrire, avoua que le temps lui manquait pour écrire une lettre brève ».
Un sentiment l’anime, qui guide en partie son écriture : la colère. Non pas celle de son père, chez qui elle était l’autre nom de la mélancolie quand sa méchanceté était celui du chagrin, non une colère contre l’époque et ses travers qui lui font écrire « des phrase orties qui piquent, et qui brûlent, des phrases-fouets qui cravachent la langue, des phrases-coup-de-poing qui cognent sans pitié, des phrases énervées, qui piaffent et s’impatientent, avant de se ruer à bride, abattu sur… après quoi, habituellement, je m’encolère de m’être ainsi encolérée. »
Comme beaucoup de livres de Lydie Salvayre, celui-ci est riche de citations, de références à des œuvres, à des écrivains qui l’accompagnent jour et presque nuit puisque l’insomnie (héritée du père) fait d’elle une lectrice passionnée. On a envie de lire Mandelstam et Sylvia Plath, Bernanos et Tsvetaeva, Swift et Diderot, avec elle. Elle a d’ailleurs consacré un bel essai à quelques autrices qui l’accompagnent. Cela s’appelle 7 femmes et chaque portrait incite à se rendre dans une bibliothèque ou une librairie.
Mais on en a assez dit sur ce beau livre-là et concluons comme elle, citant Voltaire : « le secret d’ennuyer est celui de tout dire. »
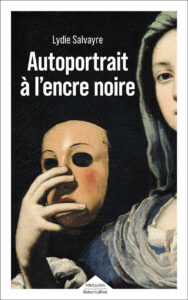 AUTOPORTRAIT A L'ENCRE NOIRE
AUTOPORTRAIT A L'ENCRE NOIRE
Lydie Salvayre
éd. Robert Laffont, 2025
Sortie en librairie le 4 septembre
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.