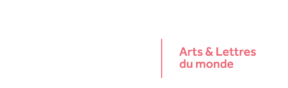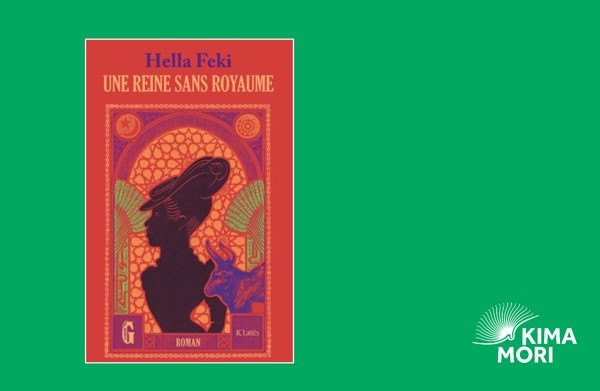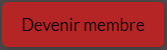Présence d’une absente
Elle n’est qu’une mention dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs, à côté du Shah de Perse et de la marquise de Villeparisis. Elle a fréquenté les salons à l’époque où Proust préparait la Recherche, mais nul ne connait la reine Ranavalona III, dernière souveraine de Madagascar exilée par le général Galliéni à Alger en 1897.
Hella Feki, romancière, lui donne voix dans Une reine sans royaume, un roman paru en ce début d’automne et c’est une découverte à tous égards, mais aussi, pour l’autrice, la confirmation d’un talent. Son premier roman, Noces de jasmin (livre de poche 2023) racontant les derniers jours de la dictature de Ben Ali, se lisait comme un thriller. La Tunisie est ici aussi le cadre principal d’une histoire emplie de mélancolie.
Dans sa postface, la romancière s’adresse à la reine, et elle dit sa difficulté : « J’ai longtemps cherché mes mots pour vous prêter ma voix. Je claudiquais, je boitillais. Un goutte-à-goutte du récit qui m’échappait ». C’est donc une souveraine qui écrit, un « je » d’un autre temps dont on acceptera le style parfois éloigné de notre langue sujet-verbe-complément au présent. Hella Feki met en relief la poésie d’une fin de siècle, de même qu’elle évoque les photographies esthétisantes prises alors par deux artistes allemands ; ils usaient des colonnes comme d’immuables décors antiquisants. C’est loin de nous, encore que.
La Tunisie où vit la reine ressemble à bien des égards à celle que nous avons découverte lors des printemps arabes. Les pauvres connaissent la famine et l’exploitation éhontée est menée alors par des colons comme l’effrayant Lucien Salles. Parfois, les instigateurs de la révolte, comme ici un certain Amor Ben Othman sont des islamistes pour qui les femmes doivent rester enfermées à la maison. Le passé et notre présent se confondent souvent. Mais l’essentiel est sans doute dans la souffrance des habitants méprisés, provoquant la naissance d’un mouvement nationaliste qui aboutira à l’indépendance, bien des décennies plus tard. En attendant, les révoltes sont réprimées dans le sang, les procès sont à charge et il faut tout le talent de Myriam Harry pour montrer les rebelles comme des humains, et non des barbares.
Myriam Harry est l’une de ces femmes qui entourent la reine dans l’épreuve de l’exil. Soutenue lors du Goncourt par Huysmans, l’écrivaine ne l’a pas obtenu. C’est pour la récompenser que des femmes ont créé le Prix Femina. Elle en a été la première lauréate.
Sa carrière a de quoi nous surprendre. Dans un monde dominé par les hommes, des personnalités comme elle se distinguent. Ranavalona fréquente les salons. Celui de Lella Beya Qmar, souveraine de Tunis, celui de la princesse Nazli d’Egypte, épouse de Khalil Pacha, homme richissime puis ruiné, premier propriétaire de « L’origine du monde », le tableau de Courbet si longtemps caché. Ces femmes sont cultivées, ouvertes à la modernité, lisent et diffusent des ouvrages de théologie musulmane qui prônent déjà l’égalité entre les genres, proposent de nouveaux droits jusque-là réservés aux hommes. Sont-elles entièrement libres ? Pas tout à fait. Elles ont été mariées contre leur gré, ont souvent subi la violence de l’époux, mais elles se sont affranchies de cette oppression. La reine déchue de Madagascar note que, comme elle, aucune n’a eu d’enfant. C’est en soi un signe de liberté.
Ranavalona III a connu l’exil forcé. Dans son entreprise de prédation, la France, représentée sur l’île de Madagascar par Galliéni ne lui a laissé aucun choix. Outre l’exploitation systématique des ressources minières, laquelle rappelle ce que nous savons de la région du Kivu au Congo, et de ses « minerais de sang », Galliéni se livre à des massacres de masse contre quiconque se révolte. Cent mille morts témoignent de cette entreprise de « pacification ». Ce ne sera pas la dernière. Une guerre coloniale bien oubliée, en 1947, a détruit une partie de l’île et de sa population. Pourtant, une correspondance entre le général français et l’exilée témoigne d’un lien de fascination entre eux.
L’histoire de Madagascar est sanglante. La grand-mère de la narratrice et mémorialiste était surnommée la « Caligula femelle ». Sa cruauté était sans limite et les pages qu’on lit à ce sujet dans le roman sont presque insoutenables. Encore que, là aussi ; notre présent rivalise d’inventivité avec ce passé dans le domaine du Mal.
La souveraine exilée cherche sa place à Alger puis à Tunis voire, lors de ses nombreux séjours, à Paris et dans d’autres villes de France. Elle la trouve ailleurs : « Mon destin renferme ce qu’il y a de plus incertain et de plus fragile. Mais je refuse de renoncer au désir du seul espace qui m’appartienne vraiment, celui du dedans, la seule retraite possible, celle de mes pensées. Je refuse que mon univers soit une cellule, que mon identité soit une geôle ». Cet espace du dedans, elle l’a entre autres créé par les livres. Sa bibliothèque est plus qu’un refuge, une source de liberté. Parmi les nombreux romans qui l’ont nourrie, Les Mille et Une Nuits, Vingt Mille Lieues sous les mers et Moby Dick occupent une place de choix : « Je renaissais par ces récits de mer ». Comme les livres se font écho, on songe à Un livre, de Fabrice Gaignault : Primo Levi est sauvé par Remorques, de Roger Vercel, histoire d’une tempête qui l’éloigne un temps de sa couche à l’infirmerie d’Auschwitz. Privilège du lecteur.
Bien que très documenté, Une reine sans royaume n’a rien d’un roman historique, au pire sens du terme. Ne serait-ce que par sa façon d’associer, sans souci d’une cohérence chronologique trop stricte. Hella Feki s’est approprié cette histoire pour en faire une rêverie, à la fois sur la reine exilée, sur une époque et sur cette Tunisie qu’elle connait pour y être née et y avoir grandi. Les descriptions que fait la reine rappelle la splendeur des palais comme Ksar Essaâda où vivent Lella Beya Qmar et Naceur Bey. Un spectacle écrit par Lucie Delarue-Mardrus autre femme ayant choisi la capitale tunisienne évoque Carthage, le rocher de Tanit, et Salammbô, de Flaubert. Les parfums imprègnent ces lieux que l’on croirait figés pour l’éternité. C’est moins idyllique que cela, nous l’avons vu.
Ranavalona fréquente les salons, les palais et elle ne dépare pas dans ces endroits tenus par l’élite (est-ce le mot) coloniale : « En ce printemps 1907, au bal de la résidence de France à Tunis, j’apparus couronnée de tresses noires, coiffée d’un chapeau gris avec une plume d’autruche perle. Dans mon costume en crêpe de Chine, bordure de jupe et ceinture à garniture vert pomme, j’avais conscience d’affoler le monde masculin, notamment le résident général ».
Ce lieu, ces circonstances ont des échos pour le lecteur : Marguerite Duras, les soirées à S Thala ou ailleurs. Bien que de passage, de façon furtive, l’ex empereur d’Annam, Ham Nghi, semble faire signe à Ranavalona. Mais ce n’est pas l’homme qu’elle aime. Cet homme, Marius Cazeneuve, « sourcier des ombres » exerce dans les Cours royales ses talents de prestidigitateur. Disons aussi qu’il apparait et disparait auprès de cette femme qui l’attend, trop souvent. Elle l’aime presque autant que sa terre natale dont elle dit en une maxime, « Nous ne rêvons jamais tant que dans nos périodes de désirs ou de douleurs, qui ne sont que des désirs blessés ». Il joue un rôle important dans la conquête de Madagascar. Rien ne dit que son amour pour la reine soit vraiment sincère.
Le goût de langue et de ses artifices est commun à la narratrice et à l’autrice franco-tunisienne : « A Madagascar, nous détenons l’art du kabary, du discours et des dérivés de sa rhétorique : savoir se taire, répondre par métaphores ou sous-entendus, induire une pensée sous-jacente, ne pas heurter l’autre par l’affrontement direct. » Une esthétique qui fait rêver, par les temps qui courent.
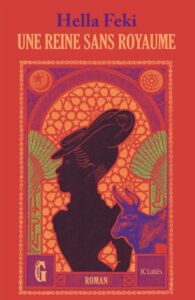 UNE REINE SANS ROYAUME
UNE REINE SANS ROYAUME
Hella Feki
éd. JC Lattès, 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.