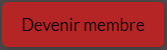« On ne voit qu’elle »
L’escalène : Dans l’étymologie ou la toponymie, une arête, une échelle, car on atteint ce lieu après bien des lacets. C’est un village dans l’arrière-pays niçois, le pays de Maryline Desbiolles. Oui, le pays comme Manosque et ses alentours est celui de Giono ou les Langhe, près d’Asti et d’Alba, celui de Cesare Pavese. Ces noms ne viennent pas au hasard. Si l’on regarde une carte, on s’aperçoit que les trois écrivains cités vivent et écrivent de ce coin de sud proche de Nice, mais bien éloigné de la ville, de ses lumières et de ses artifices. Et que l’on prenne Anchise, Dans la route, Ceux qui reviennent ou Lampedusa, le paysage du Paillon et des environs sont presque le personnage principal.
Et ce paysage se traverse par la course ; celle des êtres comme celle de la phrase qui file d’un trait à travers la page. Courir, courir « absolument », sans le souci de la performance, est l’une des activités à quoi l’on reconnaît les personnages de Maryline Desbiolles. Parmi les héroïnes de Il n’y aura pas de sang versé, histoire d’une grève des femmes à Lyon, au XIXème siècle, une jeune piémontaise traversait la campagne de cette façon. Dans d’autres romans aussi, un ou une héroïne courait à perdre haleine.
Au cœur du paysage, donc, Emma Fulconis, dont on suit la course à travers champs et collines dès la page d’ouverture de L’agrafe. Elle est au cœur de ce roman : « On ne voit qu’elle ». Cette phrase revient en leitmotiv. Et d’abord dans « l’argenture des collines », « petit point claudicant, vif-argent ». La lumière et la couleur sont indispensables. Emma comparée à une chèvre quand elle fut cheval parce qu’elle boite depuis quelque temps.
Ce n’est pas divulgâcher que de développer. Elle allait chez Stéphane Goiran, un ami avec qui elle écoute de la musique et discute de choses et d’autres. Le molosse du « père Goiran », père de Stéphane, l’a mordue à la jambe. « Mon chien n’aime pas les Arabes » s’est justifié le maitre. Opérée de ce que l’on appelait le péroné, que l’on nomme agrafe, Emma a perdu une partie de sa mobilité, de sa vitesse mais elle continue de courir et on ne voit qu’elle.
Et elle apprend maintenant que la guerre d’Algérie n’est jamais finie, dans ce coin de France, comme dans d’autres. Le père Goiran n’a pas toujours été cette brute que l’on imagine à travers sa phrase définitive sur son chien. On le verra.
Parfois les mots prennent davantage de sens quand la narratrice remonte à leurs sources. Emma souffre du « syndrome des loges » : « Loge, du francique laubja, abri de branchages, qui contient les muscles ainsi que les tendons, les vaisseaux et les nerfs. Il n’y a plus d’abri qui tienne, bien au contraire, les muscles ont enflé dans leurs loges et ne sont plus alimentés en oxygène ». De même pour les noms de lieux, qui chantent, comme dans les épopées. Maryline Desbiolles écrit en poète. Mais que l’on s’entende sur ce terme vite galvaudé. Pas question de vagues émois, de sentences hyperboliques, de sentiments faciles ; la poésie nait dans ses livres de la plus grande précision accordée au sens des mots, de leur précision scientifique, ici anatomique.
Mais revenons à Emma Fulconis, à son père mécanicien auto qui aime les rallyes et prépare les voitures à cette fin. On l’appelle « Monsieur Jemelanguis » parce que c’est le verbe qu’il répète, lorsqu’il ne fait rien. Revenons à Francine, sa mère qui dit sans cesse « Je prends sur moi ». Ce qui est tout à fait exact. Elle est la grande inquiète qui nettoie sans cesse les lieux où l’on soigne Emma parce qu’elle craint le virus fatal (à raison).
L’émancipation, elle la vivra en France, celle des tenues à la mode, des vacances pour presque rien, d’un métier qui sans l’enrichir (ce n’est pas encore une obsession) lui permet de vivre sans trop de souci.
Revenons surtout à son oncle que l’on appelle Jean-Pierre. Celui qui sait écouter les moteurs de voiture, c’est lui. Il a travaillé pour le père Fulconis. Il a tout enseigné au père d’Emma. Il s’appelle Akim, en réalité. Comme la mère d’Emma ne se prénomme pas Francine. Akim et sa sœur ont grandi près de l’Escarène, dans un « hameau de forestage », expression vide de sens, comme dire qu’on « dépose » ce hameau alors qu’on le détruit. C’est un campement de fortune réservé aux harkis, de 1963 à 1980. Les harkis, on le sait, ont été des victimes parmi d’autres de la guerre d’Algérie. Ils ont combattu aux côtés des soldats français, ont été tenus pour traitres dans leur pays d’origine, été massacrés et arrivés dans le sud de la France, dans des camps comme Rivesaltes qui avaient hébergé des réfugiés juifs, tsiganes, guinéens ou nord-vietnamiens, ils ont tout subi : la pauvreté, la faim, la maladie et le racisme.
Akim a eu pour ami de jeunesse ce père Goiran, Patrick Goiran, « beau, dandy, arrogant ». Ils échangeaient leurs 33 tours, écoutaient ensemble Frank Zappa et la musique des années 70. Un peu comme le font Emma et Stéphane. Le temps a passé, Patrick Goiran a perdu son travail, il s’est aigri, son chien s’est comporté à son image. La différence est que le chien ne savait pas ce qu’il faisait. Un « nous », celui des villageois raconte cette histoire, pour qui « il faut s’en tenir aux bribes, manques, mots écorchés ». De même qu’Emma reste insaisissable, le récit est lacunaire, rapide. Histoire au singulier ? Pas sûr : la course d’Emma fait écho à celle de Bobbi Gibb, qui courut, déguisée en homme, le marathon en 1966. Et puis, en filigrane, en lien lointain avec l’agression que subit la jeune héroïne, on retrouve un fait-divers qui s’est produit il y a quelques années à l’Escarène. Un homme a été lynché par une bande d’inconnus : ils ont lâché leurs chiens sur lui. On ignore encore les tenants et aboutissants ; l’homme est mort de ses blessures. Ce « nous » qui est parfois « je » ne sait pas tout et ne veut pas tout dire ; il laisse le récit troué, préserve des silences. Voir n’est pas savoir. Emma a survécu, échappant de peu à une amputation. Et elle danse, elle chantonne. « Elle trouve que le village est beau, qu’il vaut la peine d’être quitté ». Ce qu’elle accomplit, comme dans un vers de Cendrars. Elle part, façon pour elle de courir ailleurs, de vivre enfin loin de ces lieux hantés par un passé dont elle se détache. Façon de connaitre toutes les premières fois promises.
 L'agrafe
L'agrafe
Maryline Desbiolles
éd. Sabine Wespieser 2024
Lauréat Prix littéraire Le Monde 2024
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.